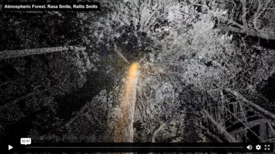La plate-forme de recherche du Bois de Finges ¶
Au début de ce siècle, dans la vallée du Rhône entre Brigue et Sion (canton du Valais), l'une des vallées alpines intérieures les plus sèches des Alpes européennes, de nombreux pins sylvestres présentaient des symptômes frappants de sécheresse. Beaucoup d'arbres plus âgés étaient déjà morts. Pour comprendre les causes de ce dépérissement, le WSL a installé au cours de l'été 2003 une expérience d'irrigation contrôlée à long terme dans le Parc naturel Pfyn-Finges. L'objectif de cette expérience est de comparer les réactions de plusieurs centaines de pins sylvestres sur des parcelles forestières irriguées avec celles d'arbres qui continuent à ne recevoir que des quantités naturelles de pluie.
Depuis 2024, nous appliquons une approche supplémentaire, unique au monde, pour démêler les processus affectés par les sécheresses de l'atmosphère et du sol. Pour plus de détails, voir l'expérience VPDrought.
Index ¶
- Résultats actuels
- Une nouvelle approche pour dissocier les effets de la sécheresse de l'air et du sol en forêt
- Équipe de projet
- Coopérations
- Sponsors
- Financement
- Dans les médias et multimedia
- Métadonnées et cartes
- Ateliers
- Conditions d'utilisation - Concept de sécurité - Politique en matière de publication et de données
- Projets
- Publications
Pour mieux comprendre les effets à moyen et long termes des périodes de sécheresse sur les forêts, il faut examiner les résultats d’essais menés dans des régions arides à l’aide de séries de mesures locales de longue durée.
Le Bois de Finges (canton du Valais; 46° 18’ N, 7° 36’ E, 615 m d’altitude) offre les meilleures conditions pour réaliser ces essais. C’est donc là, dans la plus grande pinède d'un seul tenant de Suisse, qu’une équipe de chercheurs du WSL a lancé une expérience sur 30 ans. La température annuelle moyenne y est de 10,6°C (moyenne entre 1995 et 2014) et la somme des précipitations annuelles s’élève à 575 mm (moyenne entre 1995 et 2014).
Sur ce site expérimental de 1,2 hectare, les pins ont 130 ans et mesurent 12 m de haut. Le site comprend environ 800 arbres répartis sur huit parcelles de 1000 m2 chacune (fig. 4). Quatre d’entre elles sont arrosées par aspersion entre avril et octobre et recueillent en plus chaque année 600 mm de précipitations. Les arbres des quatre autres parcelles croissent dans des conditions naturelles, à savoir relativement sèches.
Résultats actuels ¶

Presque immédiatement après le début des recherches en 2003, la production de fructifications de mycorhizes a nettement augmenté sur les parcelles irriguées. Après une année de décalage, les pins y produisent depuis 2004 des cernes plus larges et des aiguilles plus longues qu’auparavant. La longueur des pousses et la densité du peuplement ont également augmenté par la suite.
L’irrigation a en outre accéléré la croissance des racines et, à partir de l’été 2006, accru la biomasse, en particulier celle des racines fines (Brunner et al. 2009). La période de croissance des arbres irrigués s’est allongée de deux à cinq semaines (Eilmann et al. 2010).
Sur l'ensemble de la période expérimentale de 2003 à 2019, l'expérience d'irrigation nous a permis de suivre les trajectoires de récupération des arbres et de l'ensemble de l'écosystème non soumis à des conditions sèches naturelles. Les données sur 16 ans ont montré que l'irrigation a amélioré la disponibilité en eau du sol, et que les pins sylvestres de 120 ans ont retrouvé leur vigueur en augmentant la longueur des pousses, la longueur des aiguilles et la surface foliaire, et en diminuant la défoliation.
Nous avons détecté des réactions rapides et plus fortes des traits fonctionnels des arbres au-dessus du sol par rapport à ceux de la partie souterraine des arbres. L'altération des traits fonctionnels au-dessus du sol pendant les premières années d'irrigation a augmenté la demande en eau. Les arbres se sont adaptés en augmentant leur biomasse racinaire au cours des dernières années d'irrigation, ce qui a entraîné une augmentation du taux de survie des pins sylvestres dans les parcelles irriguées. Cependant, après avoir atteint un pic en 2006, l'ampleur de l'impact de l'irrigation sur un certain nombre de variables liées aux arbres a diminué au cours des années suivantes. Cette tendance à la baisse après avoir atteint le pic peut indiquer que l'approvisionnement constant en eau au fil des ans n'a pas permis de répondre à la demande en eau progressivement croissante liée à l'augmentation des activités de végétation.
Les résultats indiquent que l'augmentation de la disponibilité en eau à long terme a modifié les propriétés des arbres et de l'écosystème de telle sorte qu'un nouvel équilibre entre la disponibilité en eau du sol et la demande en eau est atteint, ce qui a modifié les conditions limites de l'écosystème. L'irrigation a également stimulé le taux de décomposition foliaire au niveau de l'écosystème, la biomasse des fructifications de champignons, et le taux de régénération chez les feuillus. L'irrigation n'a toutefois pas favorisé la régénération des pins sylvestres, réputés vulnérables aux sécheresses extrêmes (Bose et al. 2022).
Une nouvelle approche pour dissocier les effets de la sécheresse de l'air et du sol en forêt ¶
Le déficit de pression de vapeur ou VPD (en anglais Vapor Pressure Deficit) est un facteur crucial influençant la transpiration des plantes. Dans le contexte du réchauffement global, le VPD a augmenté dans le monde entier au cours des dernières décennies et peut être assimilé de manière très simplifiée à une "sécheresse atmosphérique".
Nous souhaitons distinguer les effets de cette sécheresse atmosphérique et de celle du sol sur des pins sylvestres (Pinus sylvestris).
VPDrought est la première expérience au monde consistant à manipuler l'humidité de l'air et du sol dans une forêt naturelle mature. Sous la canopée, nous renforcerons la sécheresse du sol à l'aide de toits de pluie. À l'intérieur de la canopée, un système de brumisation augmentera l'humidité de l'air, réduisant ainsi le VPD.
Ces installations complètent l'expérience d'irrigation à long terme grâce à laquelle les effets d'une sécheresse accrue du sol sont étudiés depuis 2003 dans une pinède du Bois de Finges, en Valais (voir carte). Le site dispose de nombreuses séries de données de plus de 120 mesures collectées au niveau des tissus, de l'arbre et de l'écosystème.
- Informations détaillées et accès aux données: vpdrought.wsl.ch
Pour le travail de terrain, la carte peut être téléchargée et imprimée au format A3 ou A0.
À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, l’augmentation des températures en Suisse s’élevait à plus du double de la moyenne mondiale. Les modèles climatiques laissent envisager une hausse continue pour le XXIe siècle. Compte tenu de la hausse de l’évaporation liée à la chaleur et des vagues de chaleur toujours plus fréquentes, il faut partir du principe que l’alimentation en eau des arbres continuera à empirer et il faut s’attendre à de fortes précipitations pendant les mois d’été. Ces dernières accentueront le ruissellement des eaux en surface, qui ne s’infiltreront pas. Les plantes souffriront donc de plus en plus du stress hydrique.
Par conséquent, la vitalité et la croissance des pins diminueront. La sécheresse prolongée devrait entraîner le dépérissement croissant des arbres et le déplacement des zones de végétation. Ceci s’applique particulièrement aux écosystèmes forestiers dans les vallées sèches interalpines comme le Valais (Rigling et al. 2013).
Liens sur le sujet: Recherches à long terme sur les écosystèmes forestiers LWF, l'inventaire Sanasilva.
Équipe de projet ¶
Direction du projet ¶
Suppléants ¶
Participantes et participants ¶
Coopérations ¶
Sponsors ¶
Nous apprécions le soutien de longue date d’HYDRO Exploitation SA à Sion et des services forestiers à Loèche.
Financement ¶
Dans les médias et multimedia ¶
Multimedia ¶
Pour en savoir plus: https://www.wsl.ch/drone-finges
Dans les médias ¶
Atmospheric Forest est une installation VR à grande échelle utilisant un nuage de points qui visualise et sonifie les relations entre la forêt et le climat. Elle révèle les schémas d'interaction entre les émissions des pins de Pfynwald, une ancienne forêt alpine suisse, et les conditions météorologiques dans cette vallée, affectée par la sécheresse.
Dans le bois de Finges, des chercheurs étudient les effets de la sècheresse sur les arbres au moyen de brumisateurs géants ¶
Reportage du 19h30 (RTS La Première) le 28 août 2024
Un brouillard artificiel pour tester l'impact du changement climatique sur les forêts ¶
Dossier de la RTS La Première du 29 août 2024, reportage de La Matinale (2') et sujet de CQFD (14'49")
Une nouvelle étude menée dans la forêt de Finges le montre : la sécheresse inhibe le stockage de carbone par les vers de terre. ¶
![[Translate to Französisch:] Trockenheit hemmt Kohlenstoffspeicherung durch Regenwürmer.](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_kanal9pfynwald_CO2_407637f153.jpg)
Les vers de terre en plein sommeil : en raison du changement climatique, les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues, ce qui met à mal les organismes vivant dans le sol. Une étude de longue haleine menée dans la forêt de Finges montre à quel point.
Kanal 9, 9.06.2022, Michèle Ursprung
Chercheurs : les sols forestiers secs peuvent stocker moins de CO2 à long terme ¶
![[Translate to Französisch:] Trockene Waldböden können langfristig weniger CO2 speichern](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_deutschlandfunk_CO2_b52fdee7d7.jpg)
Les sols forestiers secs ont un effet négatif sur le changement climatique, car les vers de terre en particulier ne pourraient plus bien contribuer à la fixation du carbone dans les sols, explique l'expert en cycle des matières Frank Hagedorn au Dlf. En cas de sécheresse, les vers de terre décomposent moins la litière de feuilles. A long terme, le sol stockerait ainsi moins de carbone et donc de CO2 ayant un impact sur le climat.
Ralf Krauter, Deutschlandfunk | 01. 06. 2022, 16:47
Réseau mystérieux : comment les arbres sont connectés dans la forêt ¶
Éco-acoustique : la piste sonore du changement climatique. SRF Einstein ¶
Quel est le son du sol ? Quel est le son de la forêt lors d'un été sec ? Les éco-acousticiens, comme le chercheur suisse en son Marcus Maeder, décrivent la nature de manière totalement nouvelle à l'aide d'enregistrements sonores. Le son devient l'indicateur d'un écosystème. "Einstein" montre les opportunités offertes par l'éco-acoustique.
Einstein, SRF | 21.11.2019
Mort des pins en Valais - les chercheurs enveloppent les arbres dans du plastique. ¶
Les forêts de pins du Valais sont menacées. Dans certaines régions, jusqu'à 40 pour cent des arbres sont morts au cours des deux dernières années. Ceci parce qu'il a fait particulièrement chaud et sec. La protection que les forêts concernées offrent contre les chutes de pierres et les avalanches s'en trouve réduite.
Schweiz Aktuell, SRF | 14.9.2017
Métadonnées et cartes ¶
Commencez-vous une nouvelle étude ou mettez-vous à jour une étude en cours? Veuillez télécharger le fichier Excel suivant avec les métadonnées Pfynwald, compléter vos informations actuelles en rouge et envoyer le fichier par e-mail à Marcus Schaub.
Carte
Pfynwald 2024 (3,5 Mo)
Ateliers ¶
- 2024 atelier du Pfynwald, WSL, 7 Mars 2024
- 2022 Pfynwald Workshop, WSL, 14 Feb 2022
-
2020 Pfynwald Workshop, WSL, 17 Sept 2020
-
2015 LWF-Pfynwald Workshop
- 2014 Pfynwald Workshop
- 2013 Pfynwald Workshop
Conditions d'utilisation - Concept de sécurité - Politique en matière de publication et de données ¶
Toute collaboration sur la plate-forme de recherche du Pfynwald est la bienvenue! Pour votre sécurité et pour l'intégrité du site forestier, nous demandons aux collaborateurs de prendre connaissance des conditions d'utilisation et du concept de sécurité. Notre protocole d'accord s'applique en ce qui concerne la publication et l'utilisation de données.
Projets ¶
Publications ¶
Publications du WSL ¶
Autres publications ¶
Pour citer correctement les études et données en relation avec le Bois de Finges dans votre publication, nous vous remercions de prendre en compte la citation suivante dans les remerciements (texte anglais voir ci-dessous):
«Cette étude se base sur les données de la plateforme de recherche expérimentelle à long terme du Bois de Finges, qui fait partie des infrastructures der recherche de Swiss Forest Lab et de eLTER. Nous sommes particulièrement reconnaissants à X qui nous a communiqué les données Z et à l'équipe centrale de Pfynwald pour leur soutien.»
"Evaluations are based on data from the long-term experimental research platform Pfynwald, which is part of the Swiss Forest Lab and the eLTER research infrastructures. We are in particular grateful to X who provided the Z data and the Pfynwald core team for their support."