Zustand und Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung: Resultate 2011–2017 der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz
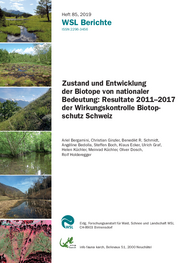
Autori:
Ariel Bergamini, Christian Ginzler, Benedikt R. Schmidt, Angéline Bedolla, Steffen Boch, Klaus Ecker, Ulrich Graf, Helen Küchler, Meinrad Küchler, Oliver Dosch, Rolf Holderegger
Collana:
WSL Berichte
85
Anno di pubblicazione:
2019
Ambito:
104 Pagine
Scaricare
Citazione:
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B.R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., … Holderegger R. (2019) Zustand und Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung: Resultate 2011–2017 der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz. WSL Berichte 85. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. 104 S.
Lingue disponibili:
